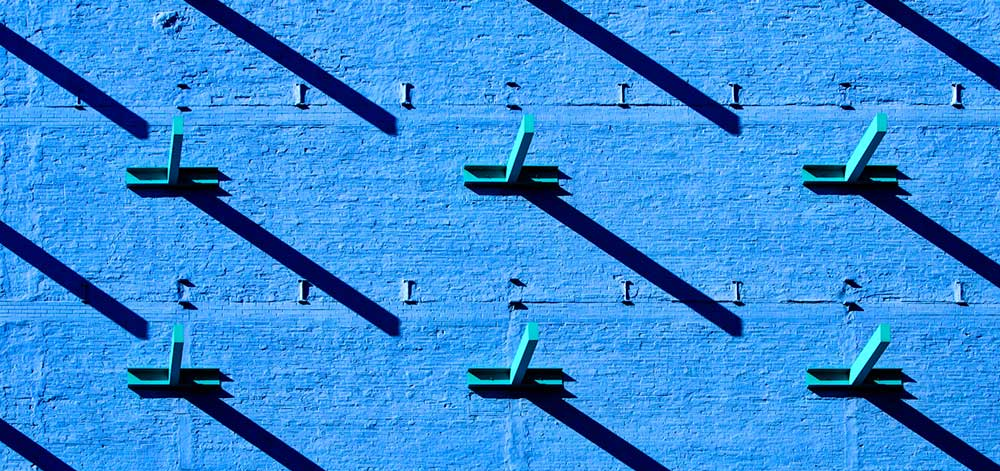I. Un dessin vaut parfois mieux qu’un long discours – Le déclin structurel de la croissance est évident
On pourrait résumer l’idée générale de cette analyse avec un simple graphique, qui représente la croissance annuelle moyenne pour chaque décennies durant ces 60 dernières années. En observant ces chiffres, repris dans le graphique ci-dessous, on est directement frappé par l’évidence du déclin structurel de la croissance économique. Alors que la croissance annuelle moyenne par habitants et par décennie était de 4,4 % dans les années 60, et supérieure à 3,1 % dans les années 70, elle tombait à 1,7 % entre 1980 et 2000. La croissance moyenne du PIB n’était plus que de 1 % dans les années 2000 et s’élève en moyenne à 0,67 % depuis 2010. Insistons sur le fait que ces chiffres représentent le PIB par habitant et par rapport à une année de référence ce qui permet d’annuler les effets de la croissance démographique et de l’inflation pour se rapprocher le plus possible d’un taux de croissance exempté des chocs de court terme sur les prix ou la production.

Source : European Commission [1]
Cette tendance se vérifie également au niveau du reste du monde et devrait s’amplifier dans les années à venir. On pourrait penser que la croissance ne fait que se déplacer (d’Europe vers la Chine par exemple) mais si l’on s’intéresse à la croissance du PIB mondial on constate également une tendance à la baisse. avec un taux de croissance annuel moyen de 5,4 % entre 1960 et 1970, 3,9 % entre 1970 et 1980, 3,1 % entre 1980 et 1990 et environ 2,7 % au-delà. De plus, les prévisions à long terme de l’OCDE suivent la même tendance tant pour les économies développées que celles en développement (1,1 % jusque 2030, 0,8 % jusque 2040, 0,6 % jusque 2050 et 0,5 % au-delà). Si ce phénomène a pu échapper aux observateurs pendant une période, aujourd’hui le constat est implacable et le FMI, l’OCDE, la Banque des règlements internationaux et bien d’autres affirment que le monde est probablement entré dans une ère de croissance faible ou de stagnation séculaire [2].

Source : OCDE [3]

Source : Banque mondiale [4]
II. Comment expliquer la baisse structurelle de la croissance ?
Lorsqu’on parle de croissance, on fait référence à la croissance de l’économie mesurée par le Produit Intérieur Brut (PIB). La notion de « croissance » est aujourd’hui tellement encrée dans nos mentalités qu’on a souvent tendance à ne même plus se poser la question de ce qui « croît ». Rappelons que la croissance ne mesure pas directement l’augmentation de notre économie ou de notre bien être mais bien la croissance du PIB soit un indicateur de la comptabilité nationale spécifiquement développé pour suivre les effets de la crise économique de 1929. Le PIB peut se calculer de trois manières différentes qui donnent mathématiquement le même résultat : la somme des productions (la somme de la valeur ajoutée de tous les agents économiques), la somme des dépenses (la consommation, les investissements, la variation des stocks, les exportations et les importations) ou la somme des revenus (les revenus des agents économiques soit les salaires, les excédents et les impôts). Une baisse de la croissance du PIB peut donc avoir de multiples explications en fonction de l’impact de ces différents facteurs.
Il existe de nombreuses théories pour expliquer cette baisse structurelle de la croissance. Les craintes de « stagnation séculaire » ont déjà été exprimée à l’égard des économies avancées depuis 1939. A l’époque il était suggéré qu’un ralentissement de l’économie aux États-Unis pouvait résulter d’une baisse du rythme de l’innovation. D’autre explications relatives aux dépenses et aux revenus sont ensuite apparues comme le ralentissement persistant de la demande qui crée un cercle vicieux en impactant négativement la production (les entreprises prévoient de vendre moins) et donc les revenus (les entreprises engagent moins ou paient moins les travailleurs) et donc à nouveau la demande. D’autres expliquent le déclin de la croissance en suivant un peu la même logique mais en soulignant l’importance de l’endettement privé et public ou les limites de la politique monétaire. Une autre explication revient sur la baisse de la productivité ainsi que la diminution relative de la part des secteurs où les gains de productivité sont les plus forts. Ainsi, entre 1950 et 2010, la productivité horaire agricole a augmenté plus de 30 fois, la productivité industrielle a été multipliée par 14 et celle des services marchands par 5. Dans le même temps, les services non marchands ont vu leur productivité doubler. Ces importants gains de productivité s’expliquent principalement par la mécanisation de l’agriculture et de l’industrie or la part dans l’économie de ces secteurs plus productifs a décliné fortement durant ces 60 dernières années. Enfin, au-delà de cet aspect quantitatif, il faut également insister sur l’aspect qualitatif. Si le PIB parvient à mesurer relativement correctement la production industrielle, il est beaucoup moins efficace pour tenir compte des gains de productivité et des services liés à la révolution numérique et digitale et semble de plus en plus dépassé par la réalité que nous connaissons aujourd’hui. Le problème ne serait donc pas nécessairement la baisse de la productivité mais la difficulté de mesurer celle-ci.
Pour certains la baisse de la croissance s’explique avant tout par le problème d’accès aux ressources. Ainsi, si la croissance a été si forte ces dernières années c’est grâce à l’abondance de ressources énergétiques bon marchés [5]. Avec le charbon, le gaz et surtout le pétrole, la quantité d’énergie accessible par personne a augmenté, entraînant la croissance du PIB. L’énergie (fossile) abondante a permis de libérer des bras et d’extraire des matières premières dans des proportions inédites dans l’histoire humaine, et de les transformer en objets de plus en plus complexes. Aujourd’hui, nous touchons les limites de ce système tant en terme de disponibilité et coût des ressources (énergétiques et autres) qu’en terme de pollution liée à leur utilisation [6]. C’est donc la fin de l’abondance des ressources qui expliquerait le ralentissement de la croissance économique.
III. La baisse de la croissance ne signifie pas nécessairement la baisse de notre prospérité et de notre bien être
La croissance économique n’est pas une garantie de prospérité pour tous. La manière la plus commune de parvenir à plus de prospérité consiste à exprimer celle-ci en termes de réussite matérielle et à recommander une croissance économique permanente pour l’atteindre. Une augmentation du Produit Intérieur Brut et des revenus plus élevés entraînent ainsi plus de possibilités de consommation et une vie plus confortable. Dans cet ordre d’idée, plus de prospérité c’est simplement plus de PIB par tête. Pourtant la corrélation entre croissance économique, réduction des inégalités et prospérité ne se vérifie pas toujours. Il est évident que la croissance économique n’a délivré ses avantages qu’inégalement et que la proportion de la population mondiale qui se trouve sous le seuil de pauvreté demeure inquiétante. Même au sein des sociétés les plus riches, une hausse de la croissance n’implique certainement pas une juste répartition de celle-ci.
À partir d’un certain seuil, ce qui compte c’est la répartition équitable des fruits de la croissance plutôt que la croissance en elle-même. Si le lien entre croissance économique et croissance du bien être peut tenir la route, dans une certaine mesure, au sein des pays les plus pauvres, il n’a plus vraiment de sens dans les sociétés les plus riches, où les besoins de subsistance sont largement rencontrés et où la consommation n’ajoute plus grand-chose au bien être des citoyens. De nombreuses études démontrent que s’il y a une corrélation positive entre revenu par tête et qualité de vie, celle-ci devient de plus en plus faible voir quasi nulle au-delà d’un certain niveau [7]. Ensuite, c’est dans les sociétés les plus égalitaires que l’indice de bien être est le plus élevé et non pas dans les sociétés les plus riches. La fin de la croissance du PIB n’est donc pas nécessairement un drame en terme de prospérité et de bien être des populations.
IV. Dépasser le mythe de la croissance est une nécessité pour penser l’avenir
Nos modèles économiques et nos sociétés sont devenus dépendants de la croissance du PIB. Le PIB est aujourd’hui la boussole de nos choix de société. Que ce soit pour financer nos politiques publiques, rembourser notre dette ou garantir l’emploi et la protection sociale nous nous reposons sur la croissance [8]. Il n’est pas rare d’entendre que même pour réaliser la nécessaire transition écologique de nos sociétés, il faut dégager des moyens et que l’unique solution est donc plus de croissance. Cette croissance économique est l’huile qui fait fonctionner nos rouages socio-économiques depuis la fin de la deuxième guerre mondiale d’où notre addiction au PIB à tous les niveaux et la difficulté d’opérer une rupture avec ce modèle [9]. Nous avons été habitués à confondre croissance et progrès ou croissance justice sociale mais aujourd’hui il devient de plus en plus évident que ce n’est pas plus de croissance qui permettra de résoudre l’essentiel des défis auxquels nous faisons face.
Le PIB possède des lacunes importantes et n’est pas un indicateur adéquat pour orienter nos sociétés [10]. Si la croissance économique en tant que telle pose de nombreuses questions, l’indicateur statistique qui permet de la mesurer est lui aussi limité. Le PIB ne mesure pas des activités aussi essentielles au bien vivre individuel et collectif que le bénévolat ou le travail domestique ni les « coûts » (externalités) humains et sociaux de la croissance et du PIB (problèmes de santé, maladies professionnelles, burn-out, etc.). De plus, le PIB ignore tout autant les impacts des pollutions de l’air et de l’eau, les « coûts » écologiques en matière d’exploitation des stocks de ressources, de la perte de biodiversité et bien entendu du réchauffement climatique et des catastrophes naturelles. En confondant le flux et le stock (qui représente la vraie richesse), le PIB nous pousse souvent dans la mauvaise direction.
La perspective d’un ralentissement économique durable et la « stagnation séculaire » offrent une fenêtre d’opportunité en faveur d’une transition vers la post-croissance. En effet, ces tendances rapprochent grandement les intérêts des forces plus conventionnels des inquiétudes exprimées par ceux qui remettent en question la croissance pour des motifs écologiques ou sociaux. Il semble bien que la croissance sur laquelle nous avons compté, non seulement pour améliorer notre qualité de vie, mais aussi pour la stabilité économique, ne soit plus disponible. La question n’est donc plus vraiment « pour ou contre la croissance » mais plutôt « comment adapter nos sociétés à une croissance faible » et comment garantir notre prospérité à tous dans ce nouveaux contexte. Le passage à la post-croissance est inévitable ; il serait préférable d’y arriver de manière volontaire et coordonnée plutôt que par la voie du désastre.
[2] Voir Tim Jackson, « Prospérité sans croissance », 2ème édition, p. 79
[3] http://www.oecd.org/fr/eco/croissance/Les-grands-enjeux-des-50-prochaines-annees-un-nouveau-virage.pdf
[5] http://www.chair-energy-prosperity.org/wp-content/uploads/2018/09/publication2018-methodologie-analyse-scenario-climat.pdf
[6] Voir Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers, « Les limites à la croissance »
[7] Voir par exemple Kate Pickett, Richard Wilkinson , « Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous »
[8] Voir par exemple https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/document-de-travail/quels-enjeux-pour-la-protection-sociale-dans-une, Isabelle Cassiers, Kevin Maréchal et Dominique Méda, « 10 thèses pour progresser vers une société de la post-croissance » ou Eloi Laurent « Pour une transition sociale-écologique – Quelle solidarité face aux défis environnementaux ? »
[9] Voir https://www.liberation.fr/debats/2018/10/10/pour-le-climat-liberons-nous-de-la-croissance_1684290
[10] Voir par exemple le rapport Stiglitz, Sen, Fitoussi : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000427.pdf ou Kate Raworth « Doughnut Economics »