Isabelle Durant, co-présidente d’écolo.
Texte extrait de l’ouvrage “Dépasser les peurs, construire un monde commun”
A lire à ce sujet :
[->art1090]
[->art1091]
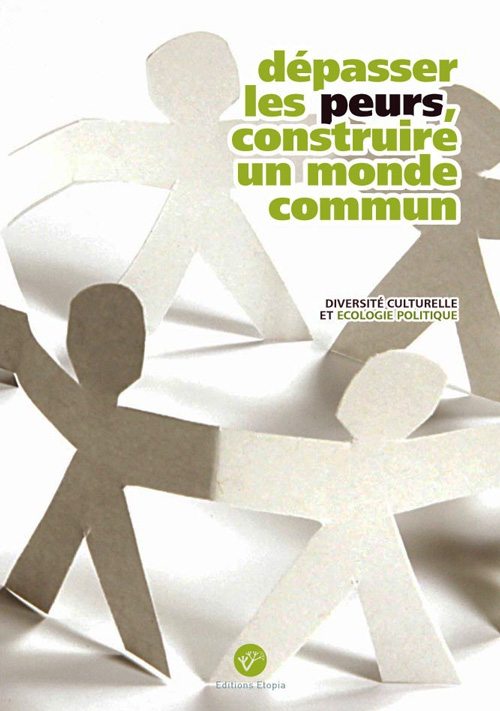
« Les humains doivent se reconnaître dans leur humanité commune, en même temps que reconnaître leur diversité tant individuelle que culturelle. »
E. Morin
Diversité : le mot est lâché. Un mot très « tendance » et dans l’air du temps, donc tout aussi solidement galvaudé. Tour à tour utilisé pour qualifier un objectif dans la composition du personnel d’une entreprise, d’un service public ou d’une équipe nationale de football, des menus « cuisine du monde » ou une collection de papiers peints ou de vêtements, le mot diversité devient paradoxalement lui-même l’objet d’une standardisation à caractère commercial.
Un autre mot, moins « tendance » celui-là, c’est « intégration ». Un mot sur la définition duquel il n’y a d’ailleurs jamais vraiment eu de consensus Une politique du même nom que certains considèrent comme un échec. Et pour cause, intégration devant signifier pour ces derniers que les destinataires de ces politiques se fondent dans le paysage général, peut-être même pour devenir noirs-jaunes-belges.
Migrations : un paysage profondément transformé
Ces malentendus, interprétations voire instrumentalisations ne sont pas le fait du hasard. Ils sont la conséquence directe des conceptions qui, ces 30 dernières années, ont inspiré les choix politiques en matière de migrations un peu partout en Europe.
Dans les années 70, c’est-à-dire dans la foulée de la crise pétrolière et de la protection de la main d’oeuvre autochtone, on est parti de la double conviction que l’immigration était globalement un mal et que la fermeture des frontières était possible. Aucune de ces idées ne s’est réalisée ou révélée exacte. Il est au contraire apparu que la migration avait des retombées positives à la fois pour les pays d’origine et pour les pays d’accueil. Là-bas, la migration constitue souvent une ressource économique majeure via les transferts de fonds des expatriés à leur famille ou les investissements qu’ils font sur place. Quant à la fermeture des frontières, elle s’est révélée une fiction et les voies d’arrivées des migrants par la porte de la demande d’asile n’ont fait que croître. Beaucoup d’entre eux et particulièrement les subsahariens risqueront ou laisseront leur vie dans la traversée tandis que la plupart auront enrichi les filières de trafic des êtres humains. A l’arrivée, ils entameront une procédure de demande d’asile, vivront en situation précaire et termineront parfois leur parcours en centres fermés, à côté de ceux qui sont devenus clandestins après avoir séjourné avec un visa qui a expiré.
Sur le terrain, la situation a également beaucoup évolué en 30 ans, depuis les premières vagues d’immigration de l’Europe du sud, suivies par celles du Maroc et de la Turquie, puis aujourd’hui par les migrations en provenance de l’est de l’Europe. Dans les faits, dans le quotidien, mais aussi dans les représentations, tantôt fondées, tantôt construites sur des peurs ou sur des clichés.
Malgré une certain proximité culturelle avec ces populations, la perspective de l’élargissement de l’Union Européenne a généré son lot de craintes (rappelons-nous, les « plombiers polonais » allaient débarquer en masse) justifiant ensuite de mauvaises décisions (le report de la libre circulation des travailleurs de ces pays, une fois l’élargissement devenu réalité).
On ne peut pas non plus nier que les suites du 11 septembre et de la « guerre du bien contre le mal » se sont fait sentir partout en Europe et dans le monde. Les expressions identitaires culturelles et religieuses se sont multipliées autant que les signes extérieurs d’appartenance et de solidarisation à une communauté au sens large. Dans un contexte largement mondialisé, ces affirmations identitaires liées de près ou de loin à l’islam donnent lieu à de multiples crispations, exacerbent les susceptibilités de tous, renforcent le repli communautaire dans ses formes les plus préjudiciables au vivre ensemble. Elles donnent lieu à des débats politiques enflammés sur la liberté d’expression, la laïcité ou la neutralité de l’espace public, l’égalité des chances entre hommes et femmes, les nouvelles mouvances dans le féminisme, le communautarisme politique comme nouvelle forme du clientélisme.
Le débat sur les fameuses caricatures de Mahomet, les batailles sur le voile, les barbus et les signes d’appartenance religieuse et philosophique auront contribué si pas à diviser, à tout le moins à jeter le trouble parmi ceux qui, il y a 30 ans, à l’avant-garde des combats pour le dialogue interculturel, se sont mobilisés sur les questions d’intégration des immigrés.
Les premiers élus verts en étaient, moi aussi. Nous avons milité aux côtés des mouvements associatifs pour le droit de vote des étrangers. Nous portions comme une valeur en soi la dissociation entre citoyenneté et nationalité, idée jugée à l’époque irréaliste et contreproductive pour l’intégration. Ce n’était évidemment pas parhasard : cette dissociation constitue le fondement même des positions vertes en cette matière.
Pour beaucoup de migrants de première génération, la nationalité est une dimension importante de l’identité d’un individu. Ce n’est pas seulement un attribut ou une couleur de carte d’identité. La quitter ou la galvauder constitue même pour certains une trahison. On ne change pas de nationalité comme de chemise. Ce qui n’empêche nullement de vivre une citoyenneté active, avec ses droits et ses devoirs.
Notre credo n’a pas changé, même si le contexte lui, s’est profondément modifié. Les deuxième et troisième générations de l’immigration ont massivement acquis la nationalité du pays d’accueil. Le débat qui a précédé l’adoption de la loi donnant le droit de vote aux étrangers non européens a été très illustratif de l’état d’esprit des partis politiques démocratiques.
Des heures durant, la discussion a porté sur les preuves d’intégration que devraient donner ces citoyens non belges. En définitive, il s’est agi d’une déclaration signée attestant de l’adhésion aux valeurs démocratiques de la constitution. Imagine-t-on une seconde qu’on demande cela aux électeurs nationaux ou européens ? Le débat a d’ailleurs tout aussi bien montré qu’il s’agissait avant tout d’un symbole dont même ceux qui le demandaient étaient convaincus de l’inutilité concrète mais persuadés de la nécessité politique.
Pour toutes ces raisons, à l’heure d’une redéfinition souvent problématique du vivre ensemble dans le contexte d’une mondialisation accrue et d’une politique d’immigration réduite à l’utilitarisme ou au sécuritaire, nous avons choisi de préciser comment les écologistes donnent aujourd’hui sens et vie à la diversité culturelle.
La diversité culturelle est aussi vitale pour la démocratie que la biodiversité pour un écosystème
La diversité culturelle est avant tout la manifestation dans l’espace public d’identités nationales, régionales, culturelles, linguistiques ou religieuses.
C’est le développement de pratiques, de coutumes, de manières de vivre, de naître, de fêter, de manger, d’accompagner les vieux, d’enterrer les morts. Conserver et exprimer ces attaches et coutumes contribuent au bien vivre, renforcent la conscience d’être « de quelque part », elle-même garante de la capacité à entreprendre un dialogue et une rencontre avec ceux qui sont « d’autre part ».
Ainsi définie, la diversité culturelle est en réalité consubstantielle de l’écologie depuis que cette dernière existe comme courant politique.
Ce n’est d’ailleurs pas sans rapport avec la défense des régionalismes et des langues minoritaires au sein des États européens, une autre racine historique de l’écologie. La démarche écologiste, universaliste par essence, se nourrit des regards croisés sur le monde, le genre humain, le patrimoine naturel, social, la diversité et le métissage des cultures, la sauvegarde de l’altérité sans pour autant ignorer l’unité du genre humain. En conséquence de quoi, les défis de la diversité culturelle, du patrimoine (à la fois matériel et immatériel), du développement économique et social ne peuvent pas être relevés séparément. Il faut les envisager comme des éléments solidaires de la même démarche, celle du développement durable.
On ne peut toutefois pas se contenter d’aligner les uns à côté des autres toute une série de particularismes identitaires. La pluralité culturelle telle que nous la concevons naît d’un dialogue entre les expressions culturelles les plus diverses, entre des personnes et groupes sociaux fragilisés ou organisés, entre des passés pertinents et des futurs désirables, entre des « ici » et des « ailleurs ». Elle est aussi un processus pour autant que les protagonistes acceptent de se laisser transformer par le dialogue engagé, qui à son tour modifiera les modes de vie et peut-être même les cadres de références. I l va de soi que ce processus ne peut s’accomplir que par la libre volonté des acteurs, jamais par la contrainte.
A la suite d’Alain Touraine, on parlera alors d’une identité offensive par rapport à une identité défensive qui ne voit dans l’autre que l’ennemi ou « l’empêcheur de danser en rond ».
Les fêtes de rue dans les quartiers, les actions spontanées de solidarité envers les familles de sans papiers sous le coup d’un ordre d’expulsion, les classes de primo-arrivants dans les écoles, sont autant de lieux et de moments où imperceptiblement, ce processus opère positivement, car sans être contraint, il est encadré, organisé. Ce maillage quotidien entre les personnes et les groupes permet de dépasser les appréhensions, de tester et d’augmenter le degré de connaissance et de confiance, de réduire les tensions.
C’est beaucoup moins le cas lorsqu’au quotidien, des manières d’être, de réagir et de penser se vivent sur le mode de la confrontation, et sont perçues comme insécurisantes. Cela peut être le cas lors de manifestations culturelles ou religieuses qui sont parfois vécues comme un envahissement, une agression. C’est encore moins le cas quand des groupes d’origines diverses importent des conflits nationaux ou internationaux et s’affrontent dans l’espace public. La mise en présence de groupes de personnes porteuses de bagages culturels différents devient alors un problème au lieu d’être un enrichissement. Les images respectives se fabriquent sur base des stéréotypes sans se donner la peine de la rencontre et de la découverte.
L’exercice de rencontre entre les cultures, les groupes sociaux et les générations est difficile et l’équilibre que ces hybridations permettent est fragile. Il l’est d’autant plus quand ceux qui à l’échelle d’un pays ou d’une région constituent une majorité sont de facto ou se perçoivent comme une minorité au sein de leur quartier ou le temps d’un trajet en transport en commun.
Reconnaître la diversité culturelle impose donc de cesser une fois pour toutes de considérer notre identité collective, source des expressions sociales, culturelles, philosophiques, religieuses, comme une substance finie, homogène, non susceptible d’évolution. En ce sens, la reconnaissance de la diversité culturelle est autant un objectif qu’un processus. Elle doit parfois pouvoir se transformer en combat contre les peurs, les conservatismes, la standardisation, le prêt-à-porter culturel.
Objectif et processus, démarche et combat, ces mots qui lui donnent sens, signifient clairement que la diversité culturelle n’est pas une évidence.
Mais ils imposent un exercice obligé, celui d’accepter de se décentrer, de refuser de ne regarder le monde que par le seul prisme occidental, et plus encore à travers le seul regard du quadragénaire blanc, cadre, consommateur et automobiliste.
La diversité culturelle est à la société démocratique ce que la diversité biologique est à son écosystème. De la même manière et par les mêmes mécanismes, la diversité culturelle est menacée comme l’est la diversité biologique et il est urgent de s’en préoccuper.
Diversité et relativisme culturel : ni l’un ni l’autre. Pourquoi pas l’utopie d’un « pluriversalisme »
Promouvoir l’expression des identités multiples en ces temps de replis identitaires et religieux, de montée des extrémismes et intégrismes impose d’être au clair sur un certain nombre de principes. Il faut donc refuser le relativisme absolu, celui qui met tout sur le même pied, considère que tout se vaut. Mais quand on a dit cela, on n’a encore rien dit. Car l’une et l’autre position extrême ne sont plus soutenables comme telles.
Ni l’ode à la différence, ni les certitudes d’un modèle qui devrait valoir partout et pour tous ne sont pertinents dans le contexte d’aujourd’hui.
Dans le meilleur des cas, ces deux attitudes sont génératrices de ces fameux « malentendus »; dans le pire, de positions qui donnent du grain à moudre à la petite phrase de G.W. Bush : « notre style de vie n’est pas négociable ».
Les positions radicalement relativistes courent le risque d’interpréter comme de simples différences les inégalités sociales ou, pis encore, d’aller jusqu’à produire des inégalités sociales du fait même de la mise en avant de différences. Le relativisme peut facilement glisser vers une conception statique et déterministe des cultures, entendues comme totalités refermées sur elles mêmes et autosuffisantes, empêchant tout changement ou évolution pour les individus ou la collectivité. En outre, il peut occulter le fait que toute culture est traversée par des conflits de classe, de caste, de genre, de génération, mais aussi par des nuances et des courants qui font sa richesse.
Les positions radicalement universalistes sont tout aussi étriquées et mal adaptées aux évolutions du monde d’aujourd’hui toujours plus hétérogène, complexe et pluriel, toujours plus marqué par les exclusions et les marginalisations sociales auxquelles cet universalisme-là ne fournit pas de réponse satisfaisante. L’usage politique de cet universalisme met en avant l’idée de la supériorité de la civilisation occidentale, et par là de son droit à imposer ses valeurs en les déclarant universelles. Ceux qui s’en font les chantres oublient un peu vite que notre civilisation a aussi –heureusement !- produit des attitudes comme le doute, la critique de soi, le respect pour des formes de vie différentes, le dialogue. Ignorer qu’il y a différents points de vue et que ceux-ci pourraient cohabiter dans le respect réciproque revient à rompre une tradition intellectuelle et culturelle européenne qui depuis des siècles, malgré les guerres et les conquêtes coloniales, a su être critique de son propre particularisme et comprendre des mondes différents du sien.
Les variantes de l’ultra-universalisme sont multiples : vite dit, vite fait, il peut s’agir d’intimider celui qui aurait des doutes sur la nécessité de l’exportation de « nos valeurs » par tous les moyens, de recaler celui qui ne partage pas l’idée d’interdire les signes religieux ostensibles, de disqualifier celui qui engage le dialogue avec des jeunes ou des femmes qui se définissent comme musulmans.
A l’inverse, il serait inacceptable qu’au nom du pluralisme culturel ou par peur d’être taxé de racisme ou de xénophobie, les progressistes abandonnent leur attachement à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, outil précieux s’il en est, et à la protection des défenseurs des droits humains. Pas question de banaliser le clientélisme communautaire, ni de faire l’impasse sur des combats de principe, comme par exemple la lutte contre l’homophobie ou pour l’égalité entre les hommes et les femmes, par peur de déplaire à tel ou tel. Il serait inimaginable que le pluralisme culturel ou religieux soit l’alibi de nouvelles discriminations.
Il faut donc redéfinir les termes de la dichotomie universalisme/ relativisme et s’orienter courageusement et de façon plus créative vers un « pluriversalisme ». L’universel et le spécifique peuvent et doivent se combiner. …Tout un chantier qui convient parfaitement aux écologistes, portés par essence sur une démarche globale et à qui complexité et modernité ne font pas peur.
La diversité culturelle à l’épreuve du marché
Paradoxalement, la globalisation et la standardisation découlant d’une économie de marché et de profit triomphante, réduisant chacun au seul statut de consommateur, ne fait que conforter le besoin de différenciation voire de particularisme. Mais dans le même temps, l’expression de la différence est plus difficile car elle va à contre courant du rouleau compresseur de la standardisation, qu’elle soit invoquée par le libéralisme ou par la social-démocratie. Si du reste on devait s’en remettre au libre marché des comportements et des biens culturels, où ce sont toujours les plus forts qui finissent par l’emporter en éliminant, comme dans tout marché, les concurrents moins puissants, nous serions tous américains ! Notons cependant que, signe des temps (le marché n’est jamais loin…), la diversité culturelle génère aussi son propre marché. Alors que par le passé, seul le retour annuel au pays ou la visite d’un membre de la famille permettait l’approvisionnement en produits du pays d’origine, la globalisation des échanges a permis le développement d’un véritable « marché de la diversité ».
Les groupes et les origines étant connus, localisés, et ayant atteint une masse critique suffisante pour rentabiliser une activité commerciale, les migrants sont eux aussi considérés avant tout comme clients de ce marché, auxquels s’ajoutent d’autres consommateurs, attirés par ces produits. De l’activité individuelle ou familiale (le « Marocain du coin », ouvert plus tard le soir), on est passé à une autre échelle, celle des multinationales de l’importation de produits pour migrants. Certaines rues ou bouts de rues accueillent des commerces et des restaurants spécialisés qui attirent des migrants de partout pour y faire leurs achats de produits spécialisés. Pas en reste, certaines grandes surfaces en fonction de leur localisation et leur clientèle, offrent également certains de ces produits, telle la viande hallal, question de ne pas perdre ce segment important de consommateurs. Certaines banques ou institutions financières se sont spécialisées dans le transfert d’argent au pays d’origine. D’autres encore prennent en charge, et parfois dans des conditions douteuses, des voyages très « low cost » vers les pays d’origine, ou organisent à grand prix le rapatriement des personnes décédées.
De la même manière, les grands groupes internationaux se sont installés partout dans le monde. On connaissait depuis des décennies les stratégies de la multinationale Coca-Cola. On voit aujourd’hui le « fast food » et les enseignes de la grande distribution qui, moyennant quelques adaptations culturelles dans leurs produits ou leur personnel, s’arrachent les marchés des nouveaux consommateurs dans les pays du Sud et les pays émergents.
Cette marchandisation de la diversité culturelle est autant une bonne qu’une mauvaise nouvelle. Bonne parce qu’en définitive, elle banalise et distribue des produits qui profitent à tous et pas seulement aux migrants dans leur pays d’accueil.
Mauvaise car pour ces produits comme pour tous les autres, ce sont des pans entiers de la production traditionnelle, à petite échelle, qui s’effondrent, au profit d’une production de masse au moindre prix.
La diversité à l’épreuve du quotidien : « unir sans confondre, distinguer sans séparer »
Les villes sont les lieux où les gens de différentes origines se rencontrent, interagissent et créent, par hybridation, de nouveaux modes d’expression culturelle. C’est donc avant tout dans nos villes, dans nos quartiers, parfois dans nos villages que les politiques d’accueil et d’intégration interrogent nos identités.
La « douceur de l’accueil » comme elle est parfois nommée Outre- Atlantique, attitude qui devrait être la règle, pourrait gagner du terrain si la reconnaissance des différences des migrants, anciens ou récents, passait par des adaptations consenties par la société d’accueil. Ces adaptations, ces accommodements, outre qu’ils témoigneraient de cette reconnaissance, permettraient d’éviter l’organisation de circuits parallèles de services, peu ou mal contrôlés.
Il en va ainsi par exemple des abattoirs provisoires lors de la fête de l’Aït El Kebir : les autorités locales, lorsqu’elles organisent cet abattage rituel, témoignent d’une compréhension et d’une attention aux besoins d’un rite religieux, mais aussi limitent l’abattage clandestin de moutons à domicile, source d’incompréhension pour les voisins s’ils ne partagent pas la même culture.
Car en effet, jusqu’où peut-on aller dans la reconnaissance et les adaptations si l’on veut conserver un espace public partagé et dans lequel toutes les populations, toutes les identités, se sentent respectées ? Si on en fait trop, n’y a-t-il pas un risque d’exacerber certains traits et comportements de ces groupes migrants, de leurs enfants, et ainsi de mettre au second plan leurs devoirs à l’égard de la société d’accueil ? Et ce faisant, garantit-on un meilleur ancrage, une vie digne, dans laquelle les générations suivantes sont moins tentées par le repli communautaire ? En renforçant leurs racines, ne leur donne-t-on pas plus aisément des ailes pour aller à la rencontre des autres ? Même si une grande partie de ces problèmes ont un caractère bien plus social que culturel, les tensions culturelles et religieuses font partie de notre vie quotidienne. C’est vrai ici et ailleurs. Les métropoles du monde rassemblent des gens très divers dont les valeurs fondamentales peuvent quelquefois diverger. Ces idées possèdent parfois de profondes racines sociales et/ou religieuses, inculquées sous forme de traditions
