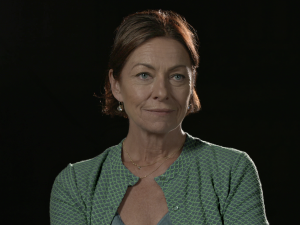Vinciane Despret
Vinciane Despret est professeure de philosophie à l’Université de Liège et spécialiste d’éthologie à savoir l’étude des comportements des animaux.
Pour cette première question, en pastichant un de vos ouvrages, nous souhaiterions vous demander, à votre avis, que nous dirait le coronavirus si on lui posait la, ou les bonnes questions?
Tant qu’on n’a pas trouvé les bonnes questions, personne ne nous dira rien de plus que ce qu’il nous dit déjà. La question n’est pas tellement de connaitre la réponse qu’il pourrait nous apporter, mais plutôt : quelles seraient les bonnes questions à lui poser? Cela, je ne sais pas. Ce n’est pas un être de ma spécialité, le coronavirus, je m’intéresse surtout aux êtres vivants sociaux. Et le coronavirus n’en est pas un à mon sens. Il est très socialisé, mais pas au sens où d’habitude, les vivants m’interpellent sur leur socialisation. La seule bonne réponse que je pourrais vous donner, et encore, sans être sure qu’elle soit bonne, n’est pas de moi. Elle vient de toutes les questions que j’ai vu poser ou coronavirus : ce sont les questions des virologues.
Et là, ça pourrait paraître bizarre parce que ça dépend dans quelles perspectives on se met. Il y a deux perspectives : soit une perspective politique à la Macron qui, dit « on est en guerre contre le virus ». Dans ce cas, les microbiologistes ne peuvent poser que les questions de guerrier, c’est-à-dire des questions d’extermination. Je ne suis pas sure que ce soit les questions les plus adéquates qui puissent lui être posées. Mais les virologues ne se considèrent pas comme en guerre avec le virus sur le même mode martial que celui du président français, je crois.
Il me semble que leur métier, c’est de connaître le mieux possible, connaître les stratégies, les sophistications, les possibilités de métamorphose. Bref, avoir une immense curiosité par rapport à ce virus et une immense curiosité pour prédire son comportement et pas seulement prédire son éradication.
La deuxième perspective me paraîtrait une piste intéressante. C’est celle que propose Bernadette Bensaude-Vincent, l’historienne des sciences, dans un superbe article paru dans Terrestres . D’après elle, ce qu’il nous faut, avec le virus, c’est de la diplomatie. Nous ne pouvons pas être en guerre avec un virus parce que cela n’a pas de sens. Il n’y a pas d’art de la guerre avec les virus, en revanche il y a des arts de la diplomatie. C’est-à-dire qu’on va devoir composer avec lui. Même le vaccin est un mode de composition avec le virus : ce n’est pas du tout le tuer, c’est l’empêcher de nuire. Ce sont des sortes de cohabitation. Un vaccin, c’est apprendre à cohabiter avec les virus. Et à partir de là, émergent des questions intéressantes. Une fois qu’on envisage que les virologues sont des scientifiques qui essayent de trouver des questions qui permettront par leurs réponses, d’entreprendre des relations diplomatiques avec le virus, cela me parait plus intéressant. C’est apprendre à atténuer ses possibilités de dangerosité un peu sauvages et inconscientes, parce qu’il y n’a pas d’intentionnalité, de volonté de nous détruire, chez le virus.
À ce moment-là, on commencera à avoir les bonnes questions et c’est aux virologues qu’il faudrait les adresser. Est ce qu’on peut poser des questions d’humains au virus, ou des questions de propagation? Je ne suis pas sure de cela. Lui, il a utilisé la voie royale qu’on lui offrait, le passage des proximités interspécifiques qui lui ont permis de persévérer et de s’épanouir sérieusement dans l’être. Ça ce ne sont pas des questions qu’il faut lui poser à lui seulement, mais aux relations d’interdépendance, d’exploitation, de cohabitation dans lesquelles il va s’inscrire et faire effraction. Lui-même pourrait nous adresser des questions, par exemple, si les virus avaient cet humour-là : « Mais comment avez-vous osé ? Comment n’avez-vous pas pensé? Comment n’avez-vous pas prévu? Comment n’avez-vous pas préparé? Comment avez-vous pu faire toutes ces conneries-là? »
Vos travaux questionnent beaucoup la notion de territoire. Dans votre ouvrage récent “Habiter en oiseaux” ou dans l’ouvrage pour petits et grands “Le chez soi des animaux”. Est-ce que cette pandémie ne vient pas interroger au fond, un éclatement paradoxal du territoire et des territoires, sur fond de mondialisation économique?
Je ne sais pas si on a un éclatement paradoxal. Il faudrait voir ce que vous appelez un éclatement paradoxal. Car d’un côté il y a, c’est vrai, un éclatement des territoires, mais d’un autre côté, il y a tous les flux qui passent tellement facilement au travers de territoires les plus hétérogènes, que j’ignore si on peut parler d’éclatement dans tous les sens. Peut-être vais-je vous renvoyer la question et dire qu’est-ce que vous pensez comme éclatement des territoires?
L’éclatement du territoire serait le fait que, par exemple, en matière d’alimentation, les aliments que nous (européen·nes) allons manger sont produits dans des territoires très éloignés et avec des coutumes aussi très, très diverses ; par contre, d’un autre côté, la réponse qui doit être donnée à la pandémie est à chaque fois, située sur un territoire qui se referme et qui vient en contradiction avec cet éclatement, par exemple, de la production alimentaire.
Oui, je comprends bien ce que vous dites, et quelque part, la question est bien pensée et donne déjà une forme de réponse. En même temps, la difficulté que j’aurais avec cette question-là : ce que j’appelle « territoire » en parlant des oiseaux, ce n’est pas tout à fait la même chose. Ce que j’appelle le territoire, c’est vraiment des terrains de vie. Ce que vous êtes en train d’évoquer n’a plus rien à voir avec des terrains de vie. Ce sont plutôt des terrains qui relèvent de la nécropolitique ou des politiques qui abîment, et qui abîment tout. On pourrait appeler ça des politiques tout-terrain, comme les chars d’armée, qui passent à travers tout, et qui écrasent tout sur leur passage.
Ce qui est appelé « éclatement de territoire » serait de l’ordre de la nécropolitique alors ?
En tout cas, dans les effets, oui, totalement, ces éclatements-là : à la fois dans cette espèce de globalisation folle, et à la fois dans cette fermeture tout aussi folle des frontières. Ce sont deux versions de la même nécropolitique : à l’égard des milieux, à l’égard des êtres, à l’égard des collectivités, à l’égard des liens, à l’égard des corps des gens.
Pensez-vous que le virus mette en relief d’une manière particulière ou qu’il nous apprend quelque chose là-dessus ou pas?
Je ne sais pas s’il nous apprend quelque chose, parce que tout ce que nous « réalisons », on le savait. Pour ne pas le savoir, il fallait être fou ou ne pas vouloir savoir. En revanche, le virus montre quelles sont les conséquences ici et maintenant, de cette nécropolitique. J’appellerais ça plutôt un effet de loupe et un effet d’intensification. On savait déjà à quel point toute cette politique de globalisation, délocalisation, etc. était néfaste. Mais tant que ça ne nous explosait pas dans les mains, on pouvait regarder ailleurs. Je crois que c’est ça aussi. Le virus nous empêche de regarder ailleurs. Parce que maintenant, c’est sous notre nez et on en paye les conséquences, certain·es moins que d’autres. Certain·es payent beaucoup plus que d’autres de façon tout à fait « cash » les conséquences.
Pour faire le lien avec ce qui vient d’être dit autour de la nécropolitique, une autre thématique de vos travaux qui résonne aujourd’hui, c’est bien sûr celle de la mort1, justement.
En ce qui concerne la situation actuelle, il y a les morts en masse, des personnes âgées esseulées dans des homes, mais aussi des morts en masse, des aîné·es qui vivent dans des communautés où le home n’est pas une option pour la Belgique et l’Europe ici, et qui prennent soin d’elles-mêmes, ces communautés, de leurs propres aîné·es. Dans tous les cas, quel que soit le lieu de vie des personnes âgées qui meurent en masse, les cérémonies qui entourent leur mort et le deuil se voient entravées Qu’observez-vous que cela nous fasse de ne pouvoir faire le « travail de deuil » aussi entouré qu’on en a la coutume? Que devient cet impératif moderne, comme vous dites, de « travail de deuil » quand ces coutumes sont rendues impossibles? Autrement dit encore, y a-t-il du politique ou du politisable dans ces deuils entravés?
Oui, oui, certainement tout à fait. Il y a du politisable et du déjà politisés. Moi, je ne parle jamais de « faire le travail de deuil ». C’est une formulation qui m’a longtemps considérablement irritée parce que c’est un héritage que je trouve vraiment trop lourd, des formes de pensées un peu tristes, des passions tristes des psys. C’est une forme de pensée qui contraindrait les gens à une laïcisation pour laquelle pas grand monde n’a vraiment d’appétit. Je ne parle jamais de travail de deuil, d’abord parce que le mot travail est horrible en soi : qui a envie de faire un « travail », de travailler cette épreuve sur ce mode cru, sur ce mode de l’oubli, de la pathologie, bref, sur tous les modes dans lesquels les psys nous les présentent. Donc, je dis simplement que les gens ont du chagrin, qu’ils traversent des épreuves, qu’ils perdent quelqu’un et que le vrai travail qui est à faire, s’il y a un travail, c’est plutôt de l’ordre d’une aventure. Je parle donc plutôt de l’aventure ou de l’épreuve (aventureuse) du deuil, même si cette aventure-épreuve est très triste et dramatique. C’est apprendre à trouver une place pour le défunt, apprendre à lui constituer une vie parmi nous, apprendre à dialoguer avec lui, apprendre à trouver la juste distance entre lui et nous. Il faut donc trouver la juste distance pour pouvoir continuer une histoire qui s’est interrompue dans le monde des vivants, mais qui continue sur d’autres modes.
Il est évident qu’à cet égard, les funérailles et les cérémonies d’hommage sont des étapes culturellement très importantes. Ce que je raconte de l’aventure du chagrin, de l’aventure de la perte, de l’aventure de « composition » avec un mort, d’apprendre à vivre de manière adéquate et même par moments agréables, cette aventure est culturellement très bien encadrée — ou moyennement encadrée— dans toutes les cultures. Les funérailles font partie d’un encadrement précieux, dans la mesure où il s’y passe des choses importantes. Il y a des gens qui viennent, qui soutiennent des vivants, qui disent aux vivants : « La personne que vous avez perdue, ou que tu as perdue, était hyper importante pour nous aussi. C’est d’ailleurs pour ça qu’on est là. Et vous, vous êtes aussi important pour nous. Et nous allons vous manifester, témoigner avec vous, notre attachement à cette personne qui s’en va et notre attachement à ce qu’elle va devenir, c’est-à-dire au mort qu’elle va devenir, et aussi notre volonté de vous aider à rester vivant. » Je crois que c’est ça qui est important.
Et puis dans l’accompagnement qui entoure les cérémonies funéraires, il y a aussi une réactivation des liens, et des solidarités. En cela, c’est très politique. Ce sont des lieux de réactivation de la vie. Et pour moi, la réactivation de la vie, c’est une thématique politique. Ensuite, dans les cérémonies, il y a souvent un moment d’hommage, qui peut prendre diverses formes, comme une lecture de texte, ou des adresses : quelque chose qui va être adressé au défunt et qui va dire comment il était. Par exemple « Notre vie a été bien plus belle avec toi » ou « je me souviens quand tu… » en évoquant même parfois des petits défauts… Ce qui est intéressant là, c’est ce que montre la théorie de Magali Molinié : à quel point ces cérémonies d’hommage sont des temps pour recomposer la personnalité du défunt et vont pour le rendre, je le dis dans mes propres termes, plus dense et plus stable pour pouvoir prolonger une relation avec lui. Il est d’ailleurs remarquable que souvent, lors de cérémonies funéraires, les gens apprennent des choses du défunt qu’ils ne savaient pas, même les proches. Pourquoi? Parce que, quand c’est bien fait, il y a divers témoignages de personnes qui ont vécu des choses très différentes avec le défunt. Les parents parfois se disent « oh mon dieu ! on croyait que c’était un petit ange et on découvre des choses assez bizarres ! » Des choses comme ça. C’est très intéressant parce que la personnalité du mort va s’en sortir plus complexe, plus dense, plus épaisse. Cela va permettre aux gens de repartir avec un mort avec lequel ils pourront vivre, avec une possibilité de futur avec ce mort. Une possibilité de non-oubli.
La question, évidemment, c’est comment on fait alors que ce n’est plus possible, pendant cette crise Covid ? Eh bien, je pense qu’on fait très mal. Et ce qui fait signe que cette histoire ne passera pas, ou ne passera pas aussi facilement que ça, ce sont les messages de colère, mais de colère épouvantable, de colère incroyable et légitime, de certaines personnes face à cette situation où ils ont été contraints de ne pas accompagner les défunts, où ils ont été contraints à être seuls face à la mort et aux funérailles.
Avez-vous une anecdote concrète par rapport à ça ?
Il y a par exemple un texte de Mathieu Yon , « Je ne vous pardonnerai pas » Ce texte est écrit suite au fait que sa compagne ait perdu sa maman et qu’elle ait dû traverser tout cela toute seule. Ça a été abominable. Mais tout a été abominable. Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui ne pardonneront pas. Je trouve que c’est intéressant de dire aux politiques « on ne peut rien faire maintenant parce que vous nous empêchez de faire quoi que ce soit, y compris de contester », et d’ajouter « je ne vous pardonnerai pas ».
Mais il y a quand même de l’inventivité. Il y a cette histoire du jeune étudiant Charles Johnen, qui est tombé accidentellement dans la Meuse à la fin d’une sortie. C’était début mars, mais on a retrouvé son corps après le début du confinement. Il y a eu deux semaines de recherche où on ne savait pas du tout ce qu’il était devenu, mais on suspectait qu’il y avait quelque chose de l’ordre d’un accident. Les parents se sont retrouvés à devoir faire les funérailles de leur fils de 20 ans en sachant qu’avec le confinement, il n’y avait pas de possibilité pour eux d’être entourés. Ça s’est passé dans le petit village de Montzen, en Belgique. Il y a des photos superbes qui montrent comment tous les jeunes gens sont allés décorer l’église avec leurs chemises de scout, avec des lettres, avec des bougies, avec des cadeaux, etc . On voit cette église remplie de dons de toutes sortes, de dons symboliques, réels, concrets, sous forme de lettre aux parents ou à Charles lui-même. Ça, c’est très inventif. Cela veut dire que les gens ont réussi à contourner l’interdit, d’une certaine manière, sans transgresser. Ils sont parvenus à faire une vraie cérémonie d’hommage, à donner un vrai accompagnement, en manifestant leur présence. Ils ont réussi à être présents sans l’être.
Ce genre de chose peut aussi exister. Bien sûr, là on est face à un collectif qui tient bien, dans un village, où les solidarités sont encore très actives, avec sans doute un jeune homme qui était très aimé. Est-ce qu’une vieille personne un peu délaissée pourra bénéficier d’autant? Sans doute non, c’est ça le problème. Tout le monde n’est pas égal dans cette histoire. Alors, qu’est-ce qu’on va faire après? Je n’en sais rien. Si je pouvais suggérer quelque chose, c’est qu’on refasse comme en Hongrie, des formes de secondes funérailles. En Hongrie ils déterrent le corps, on ne va certes pas en demander autant, ce ne serait pas nécessaire. Mais on pourrait imaginer refaire des funérailles pour ceux qui le souhaiteraient, bien accompagner les morts et les vivants une seconde fois. Un peu comme si on écrivait une lettre à postériori. Je pense qu’il y aura des cérémonies qui pourront être organisées, pour certaines personnes qui le souhaiteraient, et qui permettraient d’avoir des moments où on rend aux morts les hommages qu’on avait l’habitude de leur rendre.
Dans ces cérémonies qui sont à la fois pour les vivants et pour les morts, jusqu’ici on a plutôt parlé des vivants. Pensez-vous que cet interdit, qui pèse pour le moment sur les coutumes de la mort autour de la mort, aura des effets sur la capacité des mourants ou des morts à s’habituer à la mort? Pour reprendre l’hypothèse des sages-femmes de la mort aux États-Unis que vous citez.
D’abord il faut bien préciser, les rites que proposent les sages-femmes des morts ne s’adressent pas aux mourants. Pour elles, c’est quand on est mort qu’on doit s’habituer à être mort. Pour elles, la mort n’est pas une question du tout ou rien, c’est un processus progressif. Et donc, elles disent aux gens dont elles s’occupent : « il faut continuer à parler avec le mort, parce que si vous devez vous habituer au fait qu’il soit mort, lui aussi doit s’habituer à être mort ». C’est plein d’humour en même temps, et c’est plein de vie. Je pense que la question ne se pose pas de la même manière pour les mourants.
Mais du coup, est-ce que vous pensez que pour les morts de la pandémie, du fait que les coutumes autour de la mort sont interdites pour le moment ou réduites à peau de chagrin, cela pourrait avoir des effets aussi. Sur eux, sur leur capacité à s’habituer à la mort ?
Moi, je ne parle jamais des morts tout seul. Pour moi, les morts n’existent que dans les rapports avec les vivants. Un mort seul n’a pas d’autonomie suffisante. En tout cas, je ne peux pas, dans la tradition qui est la mienne, penser et donner de l’agentivité ou des raisons d’agir à un mort sans avoir des vivants pour impulser, inciter et être incité, etc. dans une relation. Donc, tout ce que je peux vous dire, c’est que les morts qui partent sans cérémonie d’hommage sont plus vulnérables et plus fragiles par rapport à la possibilité de continuer à exister pour les vivants, dans les collectifs. S’il n’y a pas de cérémonie d’hommage, si l’enterrement est réduit à peau de chagrin, si c’est simplement un corps dont on se débarrasse, parce qu’on n’a pas le choix de faire autrement… Il est évident que les morts qui ont traversé cette épreuve de cette façon ne sont pas les mêmes morts que les morts qui traversent des funérailles avec des gens autour, avec un collectif, avec de la solidarité, avec une cérémonie d’hommage…
Il y a une hypothèse possible, bien que ce n’est pas mon domaine de recherche, parce que je n’ai jamais travaillé qu’avec des morts que des vivants me présentaient. Pour moi, un mort seul n’existe pas ou en tous cas je n’y ai pas accès. Mais cette situation pourrait produire des fantômes. S’il y a quelque chose que l’anthropologie et l’histoire m’apprennent, c’est que ce type de mort risque de produire des fantômes. C’est-à-dire des morts mécontents ou en tous cas, des vivants qui vivent sur un mode extrêmement anxieux, désolé, triste, sur un sentiment d’inachèvement, le fait que leur défunt n’est pas du tout satisfait du sort qu’on lui a réservé. Et ça, c’est un début de processus de fabrication de fantômes, de spectralisation.
Quand je pense aux derniers fantômes auxquels j’ai eu affaire par la littérature interposée, c’est par exemple soit au Vietnam, soit en Roumanie . Du côté du Vietnam, ce sont des gens qui n’ont pas pu être enterrés ; et du côté de la Roumanie ce sont des gens qui sont morts après avoir été expulsés de leurs maisons, de leurs collectifs, etc. Et qui errent, profondément malheureux, des morts qui se sentent oubliés, qui se sentent victimes de terribles injustices, des morts qui n’ont pas trouvé ou pas reçu leur place, qui n’ont pas fait l’objet du bon traitement qui par exemple fabrique des ancêtres. Les fantômes, ce sont ceux dont, par exemple, on n’a pas retrouvé le corps pour pouvoir l’enterrer convenablement. Ici, je ne sais pas si ça provoquerait des fantômes, mais ça ressemble à une histoire qui pourrait bel et bien en produire des fantômes, si parce que les cérémonies n’ont pu être accomplies et parce que le passage de la vie à la mort s’est fait dans des conditions inhumaines. Quelle que soit la forme que prendront ces fantômes, il est évident qu’ils ne seront pas les mêmes que les fantômes américains au Vietnam, que les fantômes ou vietnamiens au Vietnam, que les fantômes roumains dans les communautés roumaines, etc.
Ce que vous nommez fantôme est donc un mort non apaisé ?
On appelle ça un mort « qui ne passe pas ». Voilà. Qui ne peut pas partir, qui ne passe pas, qui va se plaindre.
Et il s’incarne dans des symboles ou comment fait-il ?
Je ne crois pas trop qu’il s’incarne dans des symboles. Il va plutôt s’incarner dans des symptômes que dans des symboles. La manière dont les fantômes récalcitrent souvent, chez nous en tout cas, c’est dans des symptômes. C’est notre manière à nous d’être habités par les fantômes. La dernière histoire de fantômes que j’ai entendue pour la France, c’était Daniel Fabre qui en parlait. C’était une petite fille anorexique parce qu’un mort n’avait pas reçu les rituels qu’il fallait. Cela peut être des crises d’asthme chez une dame dont la maman n’a pas eu tel rituel, qu’elle aurait pu souhaiter avoir. Chez nous, les fantômes n’ont pas besoin de symbole. Ou alors on dit que les fantômes sont des êtres symboliques, ce qui est une façon de ne pas les prendre au sérieux, de les rationaliser qui m’intéresse peu. Les gens ont des prises bien plus concrètes, et ils ont des réalités assez peuplées sans qu’il soit besoin d’y ajouter des symboles.
S’il y avait une ou disons deux mesures concrètes que vous souhaiteriez suggérer à un collectif qui ne soit pas seulement partisan, ou politicien, quelles seraient-elles ? Voire, si l’on distingue, quelle mesure suggéreriez-vous au monde politique et quelle mesure au nous collectif ?
Je ne peux pas répondre à cette question, parce que ce n’est pas une mesure qu’il faut, il y a trop de choses à changer. Il y a tellement de choses à changer dans nos rapports avec les autres, dans nos rapports avec le travail, avec les corps, avec les animaux ou dans nos rapports avec la Ville, avec la politique, etc. Je ne peux pas imaginer une seule mesure parce que ce qu’il faudrait, c’est tout un système de mesures… À un moment donné je disais : « Si on veut transformer l’élevage industriel, il faut commencer par interdire l’insémination artificielle. Parce que sans elle, l’élevage industriel est sérieusement entravé. »
Ce que vous me demandez d’imaginer ici, ce serait de faire la même chose. C’est de voir quelle est la mesure qui entraverait suffisamment les choses telles qu’elles vont, de telle sorte à pouvoir commencer à faire bouger les choses, à avoir un tout petit peu de marge de manœuvre. Me demander d’inventer ça en deux minutes sans y avoir réfléchi avant, je ne peux pas, cela dépasse mes compétences
Alors pour reformuler la question, qu’est-ce que vous souhaitez dans la période trouble actuelle?
Ce que je souhaite à tous mes amis pour le moment, ce que je souhaite presque tous les jours à quantité de gens qui m’écrivent, c’est « Gardez votre colère et ne vous laissez pas épuiser par elle ».
Propos recueillis par Sophie Wustefeld
1 Au bonheur des morts, Paris, La Découverte, 2015.