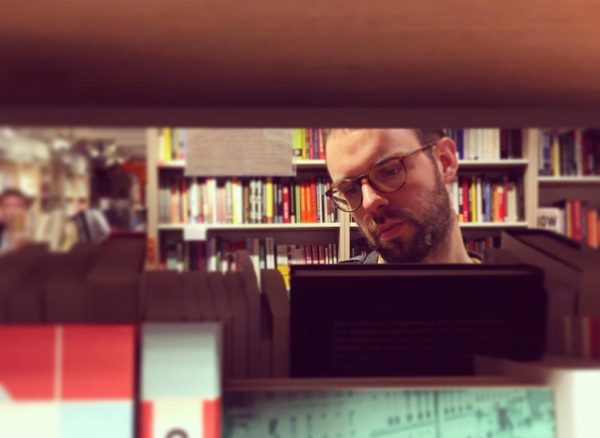Vous êtes doctorant FNRS-FRESH à l’Université Saint-Louis – Bruxelles, pouvez-vous nous préciser ce sur quoi porte votre recherche?
Ma recherche porte sur la présence congolaise, burundaise et rwandaise en Belgique et particulièrement à Bruxelles durant la période de décolonisation. Pour prendre une fourchette large, il s’agit de la période de 1945 à 1970 mais je me concentre plutôt sur la période de 1955 à 1965. Le but est d’étudier cette présence en particulier et le rapport qu’elle entretient à l’État belge à cette époque. Pour utiliser un terme générique, j’étudie ces « migrant.e.s » avant et après l’indépendance du Congo. C’est une recherche qui se base sur les archives de ce qu’on appelait à l’époque la Police des étrangers : j’étudie les dossiers d’étrangers et j’essaie de retracer le parcours et la vie de ces Congolais, Burundais, Rwandais qui se sont installés à Bruxelles mais aussi en province du Brabant. Un de mes intérêts étant d’étudier leur accès à l’université, j’ai voulu inclure l’Université catholique de Louvain.
Je voulais vraiment partir d’une question actuelle, et le projet FRESH s’y prêtait bien : la mise à l’écart de ces migrants congolais, burundais, rwandais alors même que la politique migratoire de la Belgique fait à la même époque venir en masse des Italiens, des Polonais, des Turcs. Je voulais me poser la question telle que la posent des études plus anthropologiques et sociologiques à l’heure actuelle : d’où vient cette mise à l’écart ? Est ce qu’il y a un historique? Est-ce que cette mise à l’écart est réfléchie ou est-elle la conséquence de l’importation d’une politique de ségrégation sur le territoire de la colonie ?
Je me suis notamment intéressé à ces fameux “voyages de découverte”, organisés par l’État belge à partir de 1953, et qui avaient pour ambition de faire découvrir la Belgique à une série de personnes, qu’on appelait les « évolués », soit ces Congolais que le colonisateur jugeait capables de comprendre. On envoyait ainsi chaque année 10 à 15 Congolais considérés comme ayant eu accès à un “niveau de civilisation” suffisant en Belgique. Il s’agissait surtout de Congolais, moins de Rwandais ou de Burundais. Bien évidemment, ces voyages étaient hyper encadrés, hyper surveillés. On leur faisait visiter la civilisation à la belge : les industries, la culture, le mode de vie des Belges, etc.
Comment l’État belge considère-t-il alors la place de ces migrants, de ces candidats étudiants ? Ce que j’ai surtout montré pour l’instant, c’est que le mythe de “l’étudiant congolais” est à déconstruire : il n’y a pas que des étudiants, et il n’y a pas que des hommes. Toute une série de candidats exercent des métiers plutôt techniques, plutôt liés à l’industrie aussi. C’est un groupe qui est diversifié, et dont il faut nuancer l’identité, les identités.
Avez-vous accès à des récits de vie de ces personnes ou est-ce vraiment juste les données démographiques ?
C’est le but, évidemment. Cette année devait servir à récolter une série d’entretiens fleuves qui pouvaient nourrir les données que j’avais repérées sur à peu près 3 à 4.000 dossiers. J’avais des rendez-vous prévus au Congo cet été, mais le COVID est passé par là… Il est difficile de retrouver des personnes de l’époque. Au niveau des archives, on est toujours bloqués par les 30, 50 voire 100 ans (ndlr : embargo selon la loi des archives). Il y a aussi le blocage au niveau de la protection de la vie privée : mon statut FNRS m’autorise l’accès à certaines données, mais certaines familles et certaines personnes n’ont pas nécessairement envie de donner suite. Faire ces entretiens reste mon but. Je ne conçois pas de mener une étude uniquement sur archives.
Pour revenir plutôt à la séquence qu’on a vécue d’actualité belge, comment avez-vous vécu cette séquence qui s’ouvre avec le meurtre de Georges Floyd, en tant qu’historien qui interroge justement sur ces questions migratoires et d’insertion des personnes afrodescendantes en Belgique?
C’est un mouvement qui s’inscrit dans le temps long et à la fois, même si on est sans doute encore trop proches pour le dire, on ne peut pas nier qu’on le verra très probablement comme un momentum : une phase décisive. Il y a un effet d’accélération dans l’actualité, avec notamment cette réaction du gouvernement par la voie royale, quand le roi Philippe a formulé des regrets aux Congolais.e.s pour le passé colonial. Mon espoir est qu’on n’en reste pas là, mais qu’on arrive vraiment à une prise en compte plus longue, plus approfondie, de ces enjeux. Pour moi, c’est en tout cas un moment qui contraint les historien.ne.s à prendre en considération ce qui se passe dans leur société. En tout cas, ceux qui traitent de ces questions. Ça a été personnellement mon souhait depuis que j’ai entamé ce projet, et la raison pour laquelle j’ai été très sollicité et me suis beaucoup investi, en particulier cet été. Si on étudie la question, on est obligés de s’en emparer et parfois de s’investir et d’oser prendre des risques.
Un petit point presque méthodologique. Pourriez-vous nous préciser quel est le rapport entre histoire et mémoire? Parce que cette question est abordée très tôt dans le parcours académique des historien·ne·s, mais, en même temps, elle semble faire débat aujourd’hui. Est-ce que les statues ressortent de l’histoire ou de la mémoire? Et les programmes scolaires ? Comment voyez-vous ces enjeux-là?
Vous pointez-là quelque chose de tout à fait important et même décisif dans l’actuel momentum : des confusions très récurrentes, très régulières existent sur ce que peut être l’Histoire et ce que peut être la mémoire. Si on adopte une position théorique, l’Histoire est, en résumé, une connaissance critique du passé doublée d’une confrontation entre pair·e·s. Ce n’est pas seulement l’historien·ne qui détermine cette connaissance du passé, il y a aussi l’effet de la connaissance d’une vérité, ou de ce qui s’en rapproche le plus, doublée, donc, d’une confrontation entre pair·e·s sur la connaissance de ce passé. C’est précisément cet aspect qui mène la connaissance de ce passé, l’histoire, vers une prétention scientifique. Chacun peut étudier un domaine ; mais que différents chercheurs ou chercheuses abordent la même époque, le même fait, le même processus est précisément ce qui fait qu’on tend vers une vérité peu à peu commune et confrontée. La mémoire, de son côté, est une approche du passé qui comprend une dimension affective, émotive, qui rattache l’individu qui conçoit, qui s’intéresse à ce passé du point de vue d’une appartenance à un groupe, à une identité. Je m’inspire ici de la définition d’Éric Bousmar, professeur à l’Université Saint-Louis – Bruxelles, qui a étudié les effets de mémoire à travers les différentes périodes de l’Histoire. La mémoire est une connaissance souvent partielle, qui peut être biaisée, qui peut être transformée, et qui correspond parfois à une volonté de défendre une identité ou de défendre un groupe.
Dans l’espace public autant que dans les écoles, on assiste (pas uniquement sur l’histoire coloniale) à la confrontation de mémoires : certains amènent comme une appréhension du passé, ce qu’ils appellent une connaissance, avec une réelle revendication de véracité puisque c’est le témoignage d’un grand-père, le témoignage d’un document, etc. Mais il ne s’agit pas de chose qui est croisé, qui est « confronté » par les spécialistes du passé. Ceci dit, je pense que les historien·ne·s doivent probablement arrêter d’avoir la prétention d’être les seul·e·s dépositaires du passé. Par ailleurs, ces catégories sont perméables. Depuis le milieu des années 1980, il y a un énorme intérêt, pas seulement des historien·ne·s mais aussi de différentes disciplines, pour appréhender le souvenir du passé qu’on appelle les Memory studies. Un courant se développe qui étudie le phénomène de réminiscence d’un passé : comment le souvenir se modifie ? Quels sont les événements qui contribuent à transformer, à apporter de nouvelles compréhensions ? Est-ce que ce sont les émotions ? On se trouve là dans les Memory studies influencées par la psychanalyse, la psychologie, etc. Il y a toutes sortes de disciplines qui ont une approche de la mémoire d’événements passés que les historien·ne·s étudient aussi. Le champ se complexifie, se spécialise : on ne peut plus défendre qu’il y aurait d’un côté la mémoire et l’histoire de l’autre. Il y a aussi des gens qui étudient vraiment comment un groupe, un collectif appréhende et utilise le passé. Je le répète : les historien·ne·s ne peuvent plus se présenter comme étant les uniques dépositaires spécialistes du passé.
La manifestation du 7 juin qui a réuni 15.000 personnes a remis à l’ordre du jour, notamment, la résolution qui a donné lieu à la création de la Commission Vérité et Réconciliation, et a accéléré d’autres motions dans les autres parlements. Quelle peut être la place des historien·ne·s dans ces processus de décolonisation des esprits de décolonisation et de nos institutions ?
À partir du moment où on continue à employer le mot “colonial”, à considérer que c’est un passé qui a un impact fort sur la société actuelle, j’ai trouvé intéressant le principe d’un équilibre entre historien·ne·s et autres expert·e·s, entre guillemets. j’ai trouvé que c’était un pas par rapport à ce que l’on avait fait dans la commission Lumumba, par exemple. Cette commission était composée de quatre historiens et déjà, la remise en question de l’expertise d’un historien d’origine congolaise avait été, de mon point de vue, un très mauvais signe.
Marquer un temps de réflexion a représenté un pas : réflexion tant sur le choix des intervenant·e·s que sur le fait de pouvoir compter sur des historien·ne·s de différents horizons : belge, congolais, rwandais, burundais. De mon point de vue, c’était également important d’avoir des historien·ne·s issus de mondes académiques internationaux, étant donné que, depuis la fin du vingtième siècle, ce sont des acteurs de l’international qui ont relancé la réflexion sur le colonialisme. Ça me semblait important d’avoir un regard extérieur.
Cela dit, je pense que cet équilibre n’est pas encore trouvé. La carte blanche que nous avons signée récemment avec des collègues de Gand exhortait les historien.ne·s à une nécessaire réflexion et à une réflexivité sur leur discipline(1). Nous y avons prôné une attitude modeste dans la manière de nous investir, en particulier dans cette commission, mais probablement aussi dans les différentes initiatives nées récemment, que ce soit au Parlement bruxellois ou dans certaines communes, pour appréhender l’espace public. Parce que, de mon point de vue et de celui de mes collègues de Gand, nous n’avons plus la priorité en tant qu’historien·ne·s. Nous ne sommes plus les seul·e·s dépositaires de la compréhension du passé. D’autant plus si ce passé a encore un impact aussi violent sur une partie des citoyen·ne·s belges – ce sur quoi, contrairement peut-être à d’autres collègues, je n’ai plus de doute. Nous sommes forcé·e·s de dialoguer, et surtout, nous devons, comme j’essaie de le faire dans mon projet de doctorat, nous atteler à répondre à des questions posées par la société dans laquelle nous vivons. Nous devons d’abord réfléchir sur notre discipline, c’est-à-dire nous demander quel a été le rapport de notre discipline pendant cette période coloniale et après : son rôle dans la transmission d’une mémoire de la colonisation, notre rapport à l’État et à la diffusion de nos connaissances. Cette réflexion sur la manière dont on a fait l’histoire de la colonisation belge jusqu’aujourd’hui doit avoir lieu à la fois entre nous, mais aussi avec l’aide d’autres disciplines, pour adopter une attitude modeste vis-à-vis des autres très nombreuses et nombreux spécialistes de la question de la place de ces réminiscences coloniales dans notre société.
Avoir voulu « contrebalancer » la présence des historien·ne·s dans la composition de la commission est à cet égard plutôt une bonne chose de mon point de vue, mais il y manque cruellement de spécialistes du postcolonial et du colonial. Je pense notamment à des expert·e·s de disciplines complètement absentes que sont l’anthropologie et la sociologie, voire même la philosophie, la psychologie. Ce serait nécessaire de les inclure dans la prochaine phase de la commission qui commencera dès 1er novembre 2020.
En attendant, on se dirige vers une commission “vérité et réconciliation”, ce qui, d’après ce que j’en sais jusqu’à présent, ne me semble peut-être pas la méthode adéquate et en tout cas pas idéale pour appréhender le passé colonial de la Belgique dans ses réminiscences. Le risque est de se diriger vers des solutions qui ne correspondent pas à des situations post-conflit, comme on en a connues dans le cas du Rwanda, mais aussi de l’Afrique du Sud, du Sierra Leone, ou en Amérique latine. Cette méthode est largement soutenue par des grandes institutions internationales telles que l’ONU, et j’ai l’impression que les commissions Justice et Réconciliation ont été appliquées surtout à des cas de sociétés qui sortaient de conflits. Si l’on veut aller vers ces méthodes, il faut les adapter au cas belge.
Certain·e·s militant·e·s affirment qu’en fait, si dans l’espace public on ne connaît pas assez l’Histoire, c’est parce qu’il y a eu un énorme travail de propagande. D’autres disent qu’il existe des controverses dans la discipline historique. Pourrait-on savoir ce que pensent les historien·ne·s sur ce sujet ? Par exemple, la colonisation était-elle une œuvre civilisatrice ? Des millions de personnes ont-elles vraiment été assassinées ? Pourriez-vous nous faire un peu le point sur les grands accords dans l’histoire de la colonisation du Congo comme discipline, et les points de friction entre historien·ne·s ?
Il y a en effet – et je continue à me demander pourquoi – cette idée partagée que les historien·ne·s du colonial ou bien nourrissent de profonds désaccords ou bien n’ont pas eu assez de volonté pour diffuser et transmettre leurs connaissances auprès du grand public, notamment dans l’enseignement. J’ai vraiment été étonné, parfois, de la méconnaissance profonde des étudiant·e·s. Et les contacts politiques que j’ai eus cet été me montrent qu’il y a aussi dans les anciennes et les nouvelles générations d’hommes et femmes politiques qui nous représentent en Belgique, à différents niveaux et dans différents partis, une méconnaissance qu’il faut combler. Tout cela contribue au sentiment qu’il existe des controverses, des polémiques. Des historien·ne·s d’une nouvelle génération comme Amandine Lauro (ULB), Guy Vanthemsche (VUB) ou Idesbald Goddeeris (KUL) ont publié un livre important, Le Congo colonial (2). Cet essai dit qu’en réalité, nous sommes d’accord sur énormément de choses, et ce, depuis pas mal de temps. La même Amandine Lauro avait pareillement publié, avec Benoît Henriet (VUB) (3), une carte blanche sur les grands mythes de l’histoire coloniale. Ma génération essaye de davantage transmettre.
Alors, quels sont les grands points d’accord ? En premier lieu, la violence. Les historien·ne·s s’accordent sur le fait qu’elle a eu lieu non seulement de manière très prégnante dans la société de l’État indépendant du Congo, mais qu’elle a perduré jusqu’à la fin de la colonisation, dans des formes peut-être moins visibles, mais de manière tout aussi prégnante. Il se trouvera toujours l’un ou l’autre historien·ne·s qui voudraient apporter des nuances, parfois de trop grandes nuances de mon point de vue, mais il y a un consensus scientifique là-dessus. Le deuxième point, c’est qu’il y a un racisme prégnant dans la société coloniale belge, au Congo, au Rwanda, au Burundi. Un racisme qui conduit à une ségrégation, vérifiée et constatée dans toutes les régions de ce territoire colonial. Nous avons en troisième lieu probablement trop peu diffusé de connaissances sur la motivation économique et le lien évident qu’il y a entre la Belgique puissance industrielle de la fin du 19e (l’une des premières puissances industrielles), et la Belgique qui poursuit son aventure capitaliste en dehors de ses frontières et profite d’un terrain de jeu énorme pour créer de la richesse, extraire et continuer à se placer au niveau international du point de vue économique, que ce soit avec les minerais, les diamants ou la production d’huile de palme, le caoutchouc. C’est une autre évidence pour toute la discipline : la colonisation belge a été une entreprise éminemment économique et cela reste un big business jusqu’à la fin de la colonisation. Enfin, pour rebondir sur l’aspect de « mission civilisatrice », on a repéré tout au fil du temps (et sans doute encore davantage quand le Congo devient un Congo belge à partir de 1908, puis surtout après la Première Guerre mondiale) qu’il y avait une volonté très forte de la Belgique de remodeler, d’européaniser, de « civiliser » les Congolais·e·s, Burundais·e·s, Rwandais·e·s via la politique d’éducation et les missionnaires. C’est une vision qu’on retrouve de manière globale, sur tout le territoire et sur le temps long. Voici les quatre grands points d’accord entre historien·ne·s. Reste qu’il y a encore des choses à démontrer, à prouver. En particulier : comment s’est développée la colonisation au niveau théorique, au niveau purement idéologique ? Qui ont été les idéologues ? Qui ont été les théoricien·ne·s qui ont inspiré la Belgique pour développer son projet civilisationnel ? Mais on sait que ça a existé dans pratiquement toutes les politiques par le colonisateur belge.
Et comme points de polémique, peut-être de crispation ? Est ce qu’il y a des choses sur lesquelles des historien·ne·s se confrontent, ou plutôt des champs de recherche qui restent à défricher ?
Il s’agit certes de défricher, mais surtout de diffuser. J’ai l’impression que l’actuel effort de transmission et de diffusion amènera de nouveaux financements, de quoi considérer de nouvelles questions. Comme je le disais, ces questions pourraient venir de la société, auxquelles les historien·ne·s n’auraient peut-être pas pensé et que d’autres disciplines pourraient les inviter à creuser. J’avais listé quelques exemples. Ayant travaillé sur la justice coloniale belge, je peux par exemple vous dire que beaucoup de choses restent à faire dans ce domaine pour mieux comprendre comment le système de ségrégation s’est instauré dans le Congo belge. Il s’agirait d’étudier plus avant les archives de la justice coloniale, puisque ce sont des archives récemment ouvertes, inventoriées et qui sont une source très riche pour comprendre la ségrégation. J’ai aussi noté qu’on a étudié les résistances des colonisé·e·s à l’égard du colonisateur belge, mais on doit encore creuser et faire ressortir ce que l’historienne Nancy Hunt a par exemple fait aux USA, c’est-à-dire les résistances du quotidien, les résistances culturelles et artistiques qui ont existé. Pour faire une dernière proposition, je pense qu’on a besoin d’études de cas biographiques. Quand on ne s’en tient pas aux “grandes” et “grands” de cette période, on permet de mieux montrer comment ils ont vécu telle période de la colonisation et surtout pour les Rwandais·e·s, Burundais·e·s et Congolais·e·s, quel a été le vécu de telle profession ou de tel groupe intellectuel, artistique… Il existe de nombreuses pistes, non seulement possibles mais nécessaires.
1Berber Bevernage, Eva Willems, Eline Mestdagh, Bruno De Wever et Romain Landmeters, « Commission Congo :La peur paralysante de l’historien », in Le Soir, 24 aout 2020. https://plus.lesoir.be/320703/article/2020-08-24/commission-congo-la-peur-paralysante-de-lhistorien
2 Idesbald Goddeeris, Amandine Lauro et Guy Vanthemsche (éd.), Le Congo colonial. Une histoire en questions, Waterloo, Renaissance du Livre, 2020.
3« Dix idées reçues sur la colonisation belge, in Le Soir, 8 mars 2019. https://plus.lesoir.be/211032/article/2019-03-08/carte-blanche-dix-idees-recues-sur-la-colonisation-belge
Propos recueillis par Sophie Wustefeld